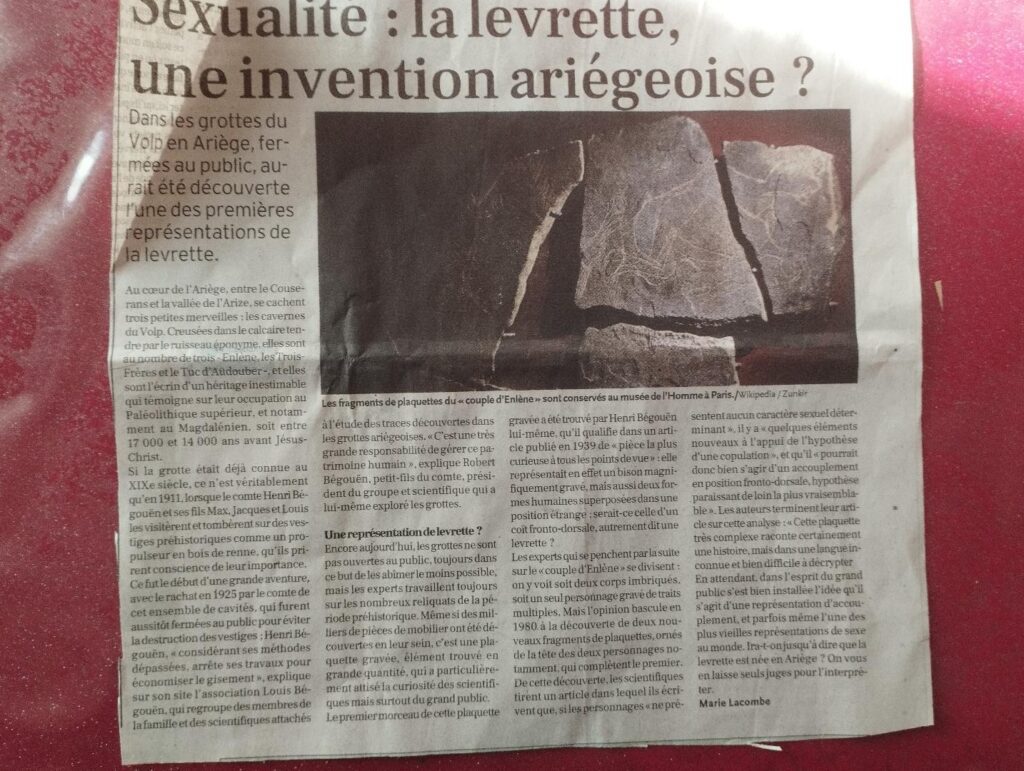
Article de La Dépêche du 08/10/2024
Gourbit. Le « coup de gueule » des élus du village – ladepeche.fr
Publié le 16/09/2024 à 05:14
Éric d’Almeida
L’Étang d’Artax, lieu historique, bien connu, apprécié et respecté par les Gourbitois. Une véritable référence, viscéralement attaché au village. « Gourbit, Artax ? Oui je connais », disent les pratiquants de la montagne, les vrais, ceux qui en connaissent les règles, ceux éduqués à sa dure loi par nos anciens qui ont aménagé ces modestes refuges et cabanes au prix d’efforts que l’on a du mal à mesurer aujourd’hui. Le refuge d’Artax fait partie de ces hauts lieux des Pyrénées ariégeoises. Un abri entretenu régulièrement, choyé, par quelques bénévoles dont il convient de saluer là le travail et le dévouement. Mais voilà qu’une poignée de « pseudos montagnards » se contente désormais d’arriver là-haut, d’investir le lieu, ouvert à tous, d’y marquer leur passage en y vidant leurs sacs, leurs flacons, sans vergogne, rentrant ensuite chez eux sans se poser la question de « qui fait le ménage ? », ou « comment celles et ceux d’après retrouveront ce « petit paradis » en altitude ? ». Le ménage ? Il n’y a pas de ramassage des ordures ménagères ici. Ce sont les randonneurs amateurs ou occasionnels, depuis toujours, qui descendent avec leurs poubelles, leurs bouteilles vides. Alors, vous qui fermez les yeux après une belle nuit à l’abri, fortement arrosée, s’il vous prend l’envie de revenir, pensez à laisser les lieux en état, pour tous, pour l’amour de la montagne, pour la reconnaissance du travail des bénévoles grâce à qui vous pouvez vous installer aux abords d’Artax. Sinon, ne venez plus, les Pyrénées se méritent, et ils méritent aussi des randonneurs éduqués, respectueux et respectables. Promis, les Gourbitois, leurs élus et leur maire ne vous en voudront pas de ne plus venir
La fête du cochon
Le porc a été une des premières espèces animales domestiquées par l’homme. Sur beaucoup de sites archéologiques du Néolithique, les dépotoirs nous livrent quantité de ses ossements
Le boucanage et les salaisons ont pu, eux aussi, apparaître très tôt dans l’histoire de l’humanité, comme mode de conservation de la nourriture carnée sur une bonne partie de l’année.
Dans le monde rural, la fête du cochon occupe une place de choix : le jour du sacrifice marque l’évènement de l’hiver, comme fête de l’abondance et de l’entraide. A cette saison, la viande se conserve bien dans les maisons : elle permet d’assurer la jonction alimentaire, toujours problématique, entre la fin des réserves de légumes de l’automne, et l’arrivée des premiers légumes de printemps.
De surcroît facile à nourrir, notamment avec des épluchures et les eaux grasses, le cochon est quasiment utilisable à 100%. La viande se mange fraîche pour les meilleurs morceaux, mais aussi se conserve sous différentes formes, pour donner de délicieux produits : saucissons, jambons, saucisses sèches… Le lard sert dans toute la cuisine rurale ; le sang permet de confectionner le « tripou » (le boudin) ; les soies seront transformées en brosses ; les intestins, soigneusement lavés, serviront d’enveloppe aux charcuteries. La vessie elle-même, sera employée pour conserver la graisse la plus fine, ou comme blague à tabac…
C’est pourquoi, chaque année, dans presque toutes les maisons montagnardes, on ressort avec beaucoup de cérémonial l’outillage nécessaire à l’abattage du cochon, puis aux différents stades de la préparation des produits à conserver : le « nauc », l’auge en planche où l’on ébouillante l’animal, le tour en bois pour le hisser au plafond de la grange, la grande planche à découper la viande (ses dimensions doivent permettre le travail de trois ou quatre personnes à la fois), et le saloir, creusé à même un tronc d’arbre.
Pour tous ceux qui y participent, la fête du cochon reste un moment privilégié de la vie vie communautaire.
Si tous se retrouvent, parents, voisins et amis, c’est bien entendu pour partager le travail, mais aussi partager le festin final, et savourer la « carbounado » (grillade du filet de porc) et le « tripou ». Lorsque les convives se séparent, dans la nuit claire de l’hiver, ce n’est jamais pour bien longtemps : quelques jours plus tard renaît la fête dans un autre foyer, pour l’abattage d’un nouveau cochon !C’est tout ce cérémonial que nous allons à présent vous raconter. C’est tout ce cérémonial que nous allons à présent vous raconter…
Le cochon, base de l’alimentation des montagnards Ariégeois, vivait le plus souvent au rez-de-chaussée de la maison dans la soue « poucirgo ». C’est là que du mois de septembre, où l’on achetait le (ou les) porcelet(s), jusqu’à l’hiver de l’année d’après, il engraissait en dévorant les légumes et pâtées que leur portait la femme de la maison toujours chargée de la basse cour. La nourriture se composait exclusivement des légumes ou fruits cultivés par le foyer : pommes de terre, betteraves, navets, pommes, choux, blettes etc… auquel s’ajoutaient les orties (il fallait se lever de bonne heure pour en trouver !) et les « mourassous » qu’il fallait aller chercher bien loin, jusqu’à la montagne d’Orlu. Le tout était cuit pendant de longues heures, soit dans une grande marmite en fonte située au-dessus d’un foyer, « la chaudièra », soit dans le chaudron, « le païrol » ou « la païrolla », dans la cheminée. Ecrasés avec un pilon, les légumes étaient arrosés de son (« le brèn ») avant d’être servis au cochon. Le chaudron était versé dans une auge en pierres taillées, « le naouc ». Les chiens et les poules profitaient aussi de cet excellent repas. Les sorties du cochon étaient restreintes : une à deux promenades par semaine dans la cour et c’était tout.
Ainsi dorloté, notre cochon, à l’âge de deux ans environ, arrivait au poids respectable de 200 à 240 kilos.
LE SACRIFICE
Le jour fatidique arrivé, dès que l’équipe hommes (entre 6 et 8) et femmes était au complet, le matériel mis en place, celui qui saignait le cochon, « le tuairo », (1) se dirigeait avec autres hommes vers la soue : il fallait attraper le cochon et l’amener sur le lieu du sacrifice. Le poste de chacun était fixé. Deux hommes jeunes et solides prendraient le cochon par les oreilles, un autre s’occuperait de la queue. Il arrivait que des hommes vieillissants et n’offrant plus toutes garanties soient relégués vers l’arrière du porc. C’était l’offense suprême mais il fallait s’y plier puisque le groupe l’avait décidé !
Le tueur prenait un fer recourbé aux deux extrémités, « le gantchou »(2). Un côté présentait une petite courbure et était très pointu, l’autre avait un cintre de bien plus grand diamètre. (On peut voir ce fer dans les mains du tueur sur la photo ci-contre). Le côté affûté était, sans ménagement, planté sous la tête du cochon qui sous l’effet de la douleur suivait. La porte de la soue passée, chacun prenait sa place, les uns aux oreilles, l’autre à la queue. L’équipage tirait donc le cochon qui poussait des » crouic crouic crouic « que chacun de nous a encore à l’oreille, vers la table d’opération. Il s’agissait souvent de la maie,« mèi », que l’on avait retournée. Ici tous les hommes présents entraient en action. Le tueur toujours à la tête, les deux qui tenaient les oreilles prenaient les pattes avant, deux autres prenaient les pattes arrière et le dernier toujours avec sa queue. Le cochon était renversé sur la maie puis ramené vers l’avant afin que sa tête se trouve dans le vide. Le tueur passait alors le côté large du crochet en fer autour de sa cuisse ce qui avait pour effet de maintenir la tête du cochon tout en libérant les mains de l’officiant
1/ « le tuairo », Les tueurs étaient au nombre de trois ou quatre par village car, comme vous allez le voir, c’était un travail très délicat dont dépendait la conservation du porc et donc la nourriture de la famille pour l’année à venir. Celui que vous voyez officier ici était l’un des plus renommés Marius BOMPART, frère de Baptistin, qui avait été formé par son père Henri, lui aussi grand tueur de cochons devant l’éternel.
1/ le gantchou ». Avant l’arrivée de cet instrument de torture très efficace, on se servait d’une petite corde solide, « le courdill », que l’on passait autour du groin et de la tête du cochon à la manière d’un licol de cheval (« mouraillaben lè porc »). Il arrivait assez souvent que le cochon se détache et se sauve, ce qui provoquait une belle panique suivie d’une belle engueulade, chacun accusant l’autre d’être la cause de l’échec et enfin de franches rigolades dans tout le village pendant des années.
Le tueur prenait son couteau,« a gabineto », très pointu et affûté pour l’occasion. Après avoir rasé les poils sous de la gorge du cochon, tâté longuement cette gorge afin de bien repérer l’artère, d’une main sure il plantait son couteau et sectionnait cette artère. Le sang jaillissait en un jet tendu, par saccades au rythme des pulsations cardiaques et était récupéré dans un chaudron ou un seau, tenu par une femme, dans lequel on avait mis du vinaigre afin d’éviter que le précieux liquide ne se caille
Le mélange sang – vinaigre, était touillé sans arrêt à l’aide d’un bâton, souvent en noisetier : « la barèjo
La barèjo
Le cochon, alors que son corps se vidait de son sang, était d’un grand calme. Mais les hommes devaient rester très vigilants et concentrés en attendant les derniers soubresauts qui faisaient se détendre les quatre pattes très vivement dans tous les sens. C’était le conseil répété chaque fois aux jeunes : attention aux secousses, « gà aï soucadidos ». Il vrai que si une patte échappait, ce pouvait être très dangereux pour le visage des hommes. Il y a eu de nombreux accidents. Quand, de l’avis général, le cochon était déclaré mort, on le descendait de la maie et on retournait cette dernière.
Deux chaînes en fer longues de 2 à 3 mètres, « lès tirans », étaient déposées en travers de la maie de telle sorte qu’elles débordent sur les côtés. L’animal était posé dans la maie sur les chaînes. Il fallait lui enlever les poils,« le pèla « .
La maîtresse de maison avait fait chauffer de l’eau qui devait être juste à point à ce moment : surtout ne pas avoir trop bouilli car : « i as coupat la forço », (littéralement « tu lui as coupé la force ») disaient les hommes en colère.
Le cochon était donc ébouillanté
A l’aide des deux chaînes il était tourné et retourné dans cette eau bouillante
Le poil ramolli, la peau bien propre et adoucie, on pouvait commencer à raser le cochon. Chaque homme s’armait d’un bout de tôle d’acier bien affûté, d’environ 5 cm sur 10 cm, souvent découpé dans une vieille faux, « la rascletto », et raclait le cochon. Le « tueur« s’occupait toujours de la tête. Il avait, pour ce faire, une raclette triangulaire pointue d’un côté. Il ne fallait surtout pas, sous peine de sévères réprimandes, entamer la couenne. Evidemment, pour pouvoir atteindre tous les côtés, il fallait retourner le cochon à l’aide des chaînes. Cette opération devait être menée rapidement car l’eau refroidissait très vite.
Le rasage terminé, le cochon était rincé et amené sur un coin de la maie. Le tueur pratiquait une incision sous les tendons des pattes arrière, dans laquelle il glissait un bout de bois en forme d’arc « la courbo » qui allait permettre de suspendre le cochon. Il détachait ensuite du corps la sortie du gros intestin, « la tripo dal cul », qu’il attachait afin que les excréments ne se déversent pas sur le cochon. Dans chaque maison, le plancher de l’étage possédait un ou plusieurs trous de 3 cm de diamètre qui permettaient de pendre le cochon. Un tour tout en bois, actionné par des bâtons, était posé en haut et relié, par une corde, à travers le trou, au bois cintré pris derrière les tendons du cochon. Il suffisait dès lors d’actionner les deux bâtons pour monter le cochon et le suspendre au-dessus de la maie. Pendant le reste de l’année ces trous étaient fermés avec des bouchons en liège ou des bouts de bois. Suite à l’arrivée du modernisme, planchers refaits en parquet ou pose de linoléums, le cochon était suspendu à une poutre en ba
Le foc de la Saint Jean
Cher Jean combien de coutumes ; de dictons, traditions, sont liés à ton nom. Le 24 juin, jour de la nativité est symbole de vie, de soleil et d’espoir. On lui attribue des pouvoirs bénéfiques pour tout et pour tous.
Ce jour là le curé bénissait le feu en récitant une prière à la gloire du plus grand Saint.
Les cierges Le deux février le curé bénissait les cierges pour se protéger de la foudre, mettre dans la chambre d’un mort, pendant l’accouchement, afin que tout se passe bien.
l’Ascension. A l’Ascension le curé bénissait les champs en se retournant aux quatre points cardinaux
Quand l’hiver s’était bien installé, il n’y avait pas grand-chose à faire dans les chaumières. La neige recouvrait le paysage, les plus jeunes s’occupaient de « soigner les bêtes », quelques moutons et une ou deux vaches. Les grands-pères quittaient l’Ariège, fin novembre, jusqu’au mois de mars. Ils se rendaient dans l’Hérault chez de grands propriétaires, tailler la vigne. Ils parcouraient près de 400 kilomètres. Cette marche durait plusieurs jours. Quand ils arrivaient, épuisés mais contents, ils étaient bien nourris, et trouvaient davantage de confort qu’ils n’avaient chez eux. La saison terminée, ils remontaient dans leur village, certains à pieds, d’autres prenaient le moyen de locomotion existant à l’époque. Ils avaient gagné un peu d’argent. Cela aidait les familles à passer le reste de l’année. Il fallait économiser pour « joindre les deux bouts ».
<<<>>>
Si quelquun a des renseignements
Bonjour
j’ai lu votre article. Je m’appelle Béatrice LAGUERRE , mon grand père était Louis LAGUERRE et mon arrière grand père Basile LAGUERRE, mon pèrec Marcel LAGUERRE dit Etienne en famille. J’essaie de reconstituer l’arbre généalogique et le patrimoine qui existait alors et connaitre leur passé: tradition, histoire familiale… Sommes nous parente et pourriez vous me renseigner ?
A Pâques
A Pâques à la sortie de l’office, on distribuait du pain bénit que l’on mangeait en récitant :
« Pain bénit, je te mange, si je meurs sert moi de sacrement.
A la Saint Roch
Pour la Saint Roch, le protecteur de la peste, on bénissait les bêtes.
Traditions de Noël
La bûche de Noël (bois) Pour la veillée de Noël, on mettait dans la cheminée « la turro de Nadal (la bûche de Noël) Elle séchait très souvent d’une année à l’autre, mais on n’exigeait pas d’elle qu’elle brûle à grandes flammes mais qu’elle se consume très lentement. (même pendant plusieurs jours) mais surtout, il ne fallait pas qu’elle s’éteignît la nuit de Noël.
Autour de cette bûche avait lieu une veillée, souvent les voisins venaient nombreux passer la soirée, en attendant la messe de minuit. Là se racontaient des histoires de fées, sorcières, loup -garous…Au retour de la messe certains faisaient réveillon avec un daube, ce qui était presque un luxe ou même tout simplement une nécessité vu que les jours qui précédaient on avait assez souvent subi un autre carême.
Le pain bénit de Noël
Certaines familles apportaient à la messe de minuit, des pains qu’elles avaient pétris et cuits elles-même. Ce pain béni à la messe de minuit avait des vertus protectrices : on en donnait aux bêtes malades, aux gens et même aux femmes en couches, pour que tout ce passe bien. Ce pain ne devait jamais être jamais jeté.
Noël et les bêtes
Les gourbitois avaient pour habitude de suralimenter les bêtes le jour de Noël (chiens, lapins, cochons…) Les vaches aussi bénéficiaient d’un régime de faveur : mangeoires plus pleine, plus de litière.
Superstition de Noël Si Noël tombait un vendredi, il y aurait beaucoup plus de mort dans l’année à venir. Il ne fallait surtout pas rentrer dans les étables le soir de Noël cela portait malheur, d’autres disaient que les bêtes parlaient et celui qui allait les écouter mourait dans l’année.
Paulette Laguerre